Venise…
Son prénom était Venise. Comme la grande ville italienne construite sur cent dix-huit îles et prisée par les touristes. Ses parents l’avaient prénommée ainsi à la suite d’un séjour dans la ville des doges.
suite d’un séjour dans la ville des doges.
Un prénom sur mesure pour cette adolescente farouche, évanescente et conquérante. Dans notre petit quartier de la fin des années 1950, il en fallait bien peu pour rompre la monotonie. Son arrivée bouleversa notre vie.
Personne ne put ignorer la présence de cette jeune fille, belle, ingénue et surtout très différente des sœurs et des copines du même âge. Elle créa tout un remous. Sa famille emménageait dans la grande maison du docteur, parti pour la ville. Les valises n’étaient pas encore défaites que, déjà, Venise avait conquis le petit quartier qui s’étirait le long du lac Saint-Jean.
Il lui avait suffi, par ce premier dimanche de juillet, de se rendre au magasin, vêtue d’une robe claire à la merci de ses mouvements en coups de vent, pour semer la commotion derrière les rideaux. Ses gestes étaient étudiés. Si les jeunes filles de son âge (13 ou 14 ans) baissaient les yeux devant un homme ou chassaient la gêne en souriant, Venise, elle, portait les siens bien haut. Ses prunelles perses prirent la couleur du lac.
Elle était la cadette d’une famille de cinq filles. Belles, libres.
Leur grande maison entourée d’une haute clôture fut assiégée par de nombreux prétendants. Sauf la dernière, elles succombèrent aux charmes d’un garçon de leur âge. Les deux plus vieilles se marièrent à un été d’intervalle.
Venise était plutôt solitaire. Elle incarnait l’amour impossible, l’impossible conquête. Cette fille aux cheveux de jais jouait à être aimée et savait répondre aux désirs sans se compromettre. Notre malheur faisait à la fois notre bonheur. Sa liberté laissait, aux jeunes que nous étions, toujours de l’espoir. Plus avertis, les adultes s’imaginaient que c’était tout simplement une petite aguicheuse. À l’école, il n’y en eut que pour elle. Elle devint la préférée des religieuses qui la trouvaient charmante et serviable. Sur leurs recommandations, ses parents l’envoyèrent étudier, l’année suivante, dans une école privée. Venise revint au milieu de l’année ; on ne sut jamais pour quelle raison. L’hiver fut moins long.
Cet été-là, elle se fit bronzer presque nue, enlevant à demi le haut de son maillot de bain. Tout autour de la grande barricade, des yeux se traçaient un chemin. Certains allèrent même sur le lac avec des jumelles. Elle s’efforçait de se camoufler derrière une haie criblée de trous.
Mon ami, qui demeurait voisin, m’offrait les premières loges. Du haut de la fenêtre de sa chambre, on examinait en détail ce corps de sirène. Elle connaissait notre présence. Je pense qu’elle s’amusait de nous voir les mains moites, les yeux multipliés et les paupières folles.
Un jour, la mère de mon ami nous surprit en pleine séance de… Mal nous en prit.
Son jeu commença à lui attirer l’animosité des autres filles et des femmes. Les filles enviaient et craignaient cette Lolita. Les dames de la paroisse mirent leur mari et leurs adolescents en garde contre cette jeune sans attaches, trop libre, trop différente et qui, contrairement au reste de sa famille, ne s’était pas intégrée à la vie du quartier. La suspicion augmenta quand elle abandonna, à trois mois de la fin de l’année, son cours à l’Institut familial. Il fallait que quelqu’un aidât sa mère.
Se complaisait-elle dans l’adolescence ? La ville était petite. On ne permettait pas d’être trop différent. Venise se trouva, bien malgré elle, isolée, pour ne pas dire ostracisée.
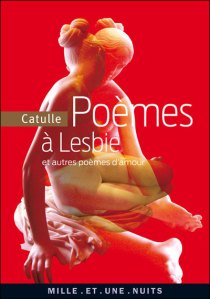 Un jour, elle disparut. Toutes sortes de bruits coururent sur ses mœurs particulières. Quelques années plus tard, la transfuge réapparut dans le quartier en compagnie d’une fille plus jeune, portant toujours un pantalon. Elles fumaient et sortaient la nuit. Toutes deux déambulaient en riant, indifférentes aux autres. Elles se promenaient avec des éclairs de dédain dans les yeux, s’assoyaient au bout du quai de la propriété familiale et buvaient de la bière à même la bouteille.
Un jour, elle disparut. Toutes sortes de bruits coururent sur ses mœurs particulières. Quelques années plus tard, la transfuge réapparut dans le quartier en compagnie d’une fille plus jeune, portant toujours un pantalon. Elles fumaient et sortaient la nuit. Toutes deux déambulaient en riant, indifférentes aux autres. Elles se promenaient avec des éclairs de dédain dans les yeux, s’assoyaient au bout du quai de la propriété familiale et buvaient de la bière à même la bouteille.
Venise s’affichait.
Je fus déçu, préférant garder le souvenir de la jeune fille qui avait soulevé une vague sur notre quartier, quelques années plus tôt. Je fus soulagé quand, après quelques jours, le couple repartit.
Notice biographique
 Jacques Girard est écrivain, journaliste, enseignant… Il est de plus un efficace animateur culturel : on ne saurait évaluer le nombre de fidèles qu’il a intronisés à la littérature québécoise et universelle. Ses écrits reflètent un humanisme lucide. De la misère, il en décrit. Aucun misérabilisme, toutefois. Il porte un profond respect à ces personnages bafoués par la vie qui hantent les tavernes, les restos et les bars semi-clandestins de sa ville. Il les connaît bien, et il ne se distancie pas d’eux. Il a conscience d’appartenir à la même espèce, pour paraphraser Lawrence Durrell. Nous considérons Des nouvelles du Lac son chef d’œuvre. Mais il nous a aussi donné, entre autres, Fragments de vie, Les Portiers de la nuit et Des hot-dogs aux fruits de mer.
Jacques Girard est écrivain, journaliste, enseignant… Il est de plus un efficace animateur culturel : on ne saurait évaluer le nombre de fidèles qu’il a intronisés à la littérature québécoise et universelle. Ses écrits reflètent un humanisme lucide. De la misère, il en décrit. Aucun misérabilisme, toutefois. Il porte un profond respect à ces personnages bafoués par la vie qui hantent les tavernes, les restos et les bars semi-clandestins de sa ville. Il les connaît bien, et il ne se distancie pas d’eux. Il a conscience d’appartenir à la même espèce, pour paraphraser Lawrence Durrell. Nous considérons Des nouvelles du Lac son chef d’œuvre. Mais il nous a aussi donné, entre autres, Fragments de vie, Les Portiers de la nuit et Des hot-dogs aux fruits de mer.



 Publié par Alain Gagnon
Publié par Alain Gagnon 
































