Nostalgie et signification
(Notes pour une esthétique du récit)
(a)
En me rapprochant de ma nostalgie, je comprends mieux l’ultime projet qui s’offre à l’écrivain : écrire un livre qui ne porte sur rien, dans lequel
toute signification serait suspendue afin que le sens, qui ne peut que différer, advienne. Songez-y un instant : croyez-vous vraiment que votre nostalgie se rapporte à des événements passés ? La nostalgie cherche plutôt à saisir ce qui jamais n’arriva. Le nostalgique projette sur le phantasme du passé son phantasme de plénitude (il y aurait donc phantasme redoublé). Dans la nostalgie, nous faisons cette expérience paradoxale de la présence sans cesse différée mais en réalité si poignante de ce qui ne fut jamais. Nous devons comprendre que ce sont des absences qui donnent sens à la vie. Les Idées de monde et d’âme sont des formes vides qui orientent la pensée ; et pourtant ces Idées sont ce qu’il y a de plus nécessaire. L’expérience concrète ne nous livre en réalité que des impressions parcellaires du monde comme de l’âme ; seuls les mystiques (peut-être) pourraient expérimenter dans toute leur vérité la richesse substantielle du cosmos et du moi; pour le reste, nous autres, pauvres mortels, nous n’expérimentons dans les Idées que ce qui sans cesse différé n’en donne pas moins sa nécessaire cohésion à l’ensemble indéfini de nos perceptions.
(b)
Il y a dans la vie des séquences qui captent mystérieusement ces significations latentes dont sont riches ces inconnues qui nous convainquent de la réalité du réel. Si j’en crois ma propre expérience comme certains romans, les souvenirs des premiers moments où l’on se sépare de l’ordre familial sont les plus propices à réveiller notre nostalgie d’une plénitude qui serait comme la réalisation de ce que les Anciens et les scholastiques appelaient les transcendantaux. Pour plus d’un homme, ces moments jamais vécus mais déterminants se confondent avec une atmosphère de féminité diffuse. La Femme, en effet, quel bel exemple de surfantôme qui assure leur apparente cohérence à des continents psychologiques qui par moments nous semblent plus solides que le roc et que baignent pourtant les eaux absentes du pur néant.
(c)
La naissance de la philosophie moderne est caractérisée par le doute (Descartes), doute qui permet à l’intelligence de connaître son essence propre dans l’expérience du cogito (doute dont Husserl, faut-il ajouter, tirera toutes les conséquences beaucoup plus tard). Mais avant d’être thématisé par le philosophe français, le doute et son corrélat psychologique, l’ambigüité, fit son apparition dans l’œuvre de Shakespeare, tout spécialement dans son Hamlet dont le héros est peut-être le premier personnage réellement moderne.
Cette mise en avant du doute représente une révolution qui affecta tout l’art du récit, jusqu’au drame théâtral. Les Anciens, croyant en un telos immanent qui meut le cosmos comme tout être vivant, croyaient que l’œuvre littéraire devait elle-même être douée d’entéléchie, ce dont les poèmes épiques d’Homère donnent un bon exemple. Chez nous, modernes, cette foi dans la finalité comme condition du sens est remise en question. Le sens est pour nous suspendu, à venir. Or l’esthétique est solidaire d’une telle mentalité. Nos récits sont le plus souvent des tranches de vie : il y a bien sûr des événements, mais on ne voit pas entre ces événements les liens nécessaires qui conduisent immanquablement à une chute précise.
Il y aurait long à dire sur l’expérience du sens comme sens différé. Il ne s’agit pas, selon moi, d’une réalité purement négative : elle permet ce libre jeu de la pensée qui de Fichte à Hegel engendra la vision dialectique du réel. On pourrait ajouter qu’au niveau littéraire, elle ouvre la perspective d’une œuvre dans laquelle la vérité du sens comme différé et différence devient enfin manifeste.
(d)
Je rêve donc du roman de la nostalgie. Ce serait le roman le plus moderne que l’on puisse imaginer. Au fond on est nostalgique parce que le
sens fait défaut ; on aspire donc à des amours passées, à des époques révolues. Mais ces époques, ces amours, sont plutôt le rêve de ce qui fut et non ce qui fut vraiment. On pourrait dire que l’objet du nostalgique est une absence qui en tant qu’absence capte toutes les significations dont est riche sa vie intérieure.
Pénétrez-vous de ces idées au fond très simples : la femme la plus belle est celle que l’on n’embrassera jamais, et c’est son impossibilité même qui rend l’amour possible.
Notice biographique
 Frédéric Gagnon a vécu dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Kingston et Chicoutimi. Il habite aujourd’hui Québec. Il a étudié, entre autres, la philosophie et la littérature. À ce jour, il a publié trois ouvrages, dont Nirvana Blues, paru, à l’automne 2009, aux Éditions de la Grenouille Bleue. Lire et écrire sont ses activités préférées, mais il apprécie également la bonne compagnie et la bonne musique.
Frédéric Gagnon a vécu dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Kingston et Chicoutimi. Il habite aujourd’hui Québec. Il a étudié, entre autres, la philosophie et la littérature. À ce jour, il a publié trois ouvrages, dont Nirvana Blues, paru, à l’automne 2009, aux Éditions de la Grenouille Bleue. Lire et écrire sont ses activités préférées, mais il apprécie également la bonne compagnie et la bonne musique.






 Publié par Alain Gagnon
Publié par Alain Gagnon 









 coucher et vit sa femme pelotonnée dans le lit — mais c’était pourtant une autre. Il se rendit donc dans la chambre de sa fille, espérant que cet être le rattacherait à lui-même, à son identité, à tout un passé qui lui paraissait définitivement étranger. Il vit l’enfant dans son pyjama rose, dormant les jambes écartées. Il y avait au coin gauche de ses lèvres un filament de salive. Décidément, il ne retrouvait pas le sentiment de sa propre paternité. Mais qui était donc cette fillette de cinq ou six ans ? Découragé, vidé de lui-même tel un fantôme qui circule dans une maison inconnue, il descendit au sous-sol où se trouvait son bureau. Il examina le manuscrit de ce roman que supposément il était en train d’écrire. L’histoire en était absurde. Ces milliers de mots s’effilochaient dans son esprit ; leur lecture pénible l’écœurait, comme s’il eût sucé quelque bonbon doucereux qui lui rappelait une enfance qui ne pouvait avoir été la sienne. Il ramassa le paquet de Gauloises, à côté de l’ordinateur portable, et alluma une cigarette, puis il tenta de réfléchir à sa situation, mais toute pensée claire se refusait à lui. Alors qu’il éteignait le mégot dans le cendrier de métal doré, il aperçut une feuille de papier, vraisemblablement déchirée en son milieu, qui reposait sur le coin gauche de sa table de travail. Ce papier était porteur d’un message, d’une note manuscrite qu’il avait sans doute rédigée lui-même, mais dont il ne reconnaissait pas l’écriture. Attentivement, il lut, puis relut : Est-ce que le monde est dans ma tête ? Est-ce moi qui suis dans le monde ? Ces questions (mais au fait, à qui s’adressaient-elles ?) lui donnaient une sensation de vertige. En un sens, mais il n’aurait su préciser lequel, il sentait que ces questions-là étaient intimement liées à la perte de son identité. Qu’était-ce donc, être moi-même ? se demanda-t-il. Qui étais-je, quand tout empli d’une personnalité nette et précise comme le tranchant d’un couteau, j’étais habité par le sentiment de ma propre présence ? Il pressentait qu’il s’interrogeait en vain. Il fuma une seconde cigarette, mais cette fois ne tenta pas de réfléchir. Puis, harassé par un monde d’ombres qui s’entassaient dans cette pièce comme les éléments dissous d’un univers à jamais perdu, il retourna au rez-de-chaussée et sortit sur le perron. Il vit le ciel, d’un bleu absolu, bleu comme l’amour qu’on ne retrouvera jamais, comme les yeux d’une femme qui nous manque bien qu’on ne l’ait jamais connue — et il constata que ce ciel était identique à celui de la veille. Il en conçut du dépit.
coucher et vit sa femme pelotonnée dans le lit — mais c’était pourtant une autre. Il se rendit donc dans la chambre de sa fille, espérant que cet être le rattacherait à lui-même, à son identité, à tout un passé qui lui paraissait définitivement étranger. Il vit l’enfant dans son pyjama rose, dormant les jambes écartées. Il y avait au coin gauche de ses lèvres un filament de salive. Décidément, il ne retrouvait pas le sentiment de sa propre paternité. Mais qui était donc cette fillette de cinq ou six ans ? Découragé, vidé de lui-même tel un fantôme qui circule dans une maison inconnue, il descendit au sous-sol où se trouvait son bureau. Il examina le manuscrit de ce roman que supposément il était en train d’écrire. L’histoire en était absurde. Ces milliers de mots s’effilochaient dans son esprit ; leur lecture pénible l’écœurait, comme s’il eût sucé quelque bonbon doucereux qui lui rappelait une enfance qui ne pouvait avoir été la sienne. Il ramassa le paquet de Gauloises, à côté de l’ordinateur portable, et alluma une cigarette, puis il tenta de réfléchir à sa situation, mais toute pensée claire se refusait à lui. Alors qu’il éteignait le mégot dans le cendrier de métal doré, il aperçut une feuille de papier, vraisemblablement déchirée en son milieu, qui reposait sur le coin gauche de sa table de travail. Ce papier était porteur d’un message, d’une note manuscrite qu’il avait sans doute rédigée lui-même, mais dont il ne reconnaissait pas l’écriture. Attentivement, il lut, puis relut : Est-ce que le monde est dans ma tête ? Est-ce moi qui suis dans le monde ? Ces questions (mais au fait, à qui s’adressaient-elles ?) lui donnaient une sensation de vertige. En un sens, mais il n’aurait su préciser lequel, il sentait que ces questions-là étaient intimement liées à la perte de son identité. Qu’était-ce donc, être moi-même ? se demanda-t-il. Qui étais-je, quand tout empli d’une personnalité nette et précise comme le tranchant d’un couteau, j’étais habité par le sentiment de ma propre présence ? Il pressentait qu’il s’interrogeait en vain. Il fuma une seconde cigarette, mais cette fois ne tenta pas de réfléchir. Puis, harassé par un monde d’ombres qui s’entassaient dans cette pièce comme les éléments dissous d’un univers à jamais perdu, il retourna au rez-de-chaussée et sortit sur le perron. Il vit le ciel, d’un bleu absolu, bleu comme l’amour qu’on ne retrouvera jamais, comme les yeux d’une femme qui nous manque bien qu’on ne l’ait jamais connue — et il constata que ce ciel était identique à celui de la veille. Il en conçut du dépit.















 Frédéric Gagnon a vécu dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Kingston et Chicoutimi. Il habite aujourd’hui Québec. Il a étudié, entre autres, la philosophie et la littérature. À ce jour, il a publié trois ouvrages, dont Nirvana Blues, paru, à l’automne 2009, aux Éditions de la Grenouille Bleue. Lire et écrire sont ses activités préférées, mais il apprécie également la bonne compagnie et la bonne musique.
Frédéric Gagnon a vécu dans plusieurs villes canadiennes, dont Montréal, Kingston et Chicoutimi. Il habite aujourd’hui Québec. Il a étudié, entre autres, la philosophie et la littérature. À ce jour, il a publié trois ouvrages, dont Nirvana Blues, paru, à l’automne 2009, aux Éditions de la Grenouille Bleue. Lire et écrire sont ses activités préférées, mais il apprécie également la bonne compagnie et la bonne musique.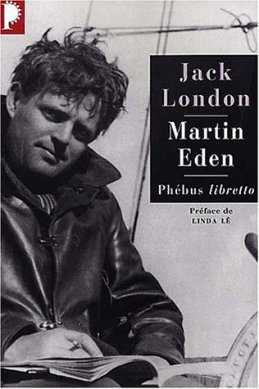 Roman d’apprentissage, roman de l’amour déçu, Martin Eden de Jack London (1876-1916) est un authentique chef-d’œuvre qui raconte l’odyssée morale et spirituelle d’un jeune homme d’humble origine, Marin Eden, en quête de gloire littéraire.
Roman d’apprentissage, roman de l’amour déçu, Martin Eden de Jack London (1876-1916) est un authentique chef-d’œuvre qui raconte l’odyssée morale et spirituelle d’un jeune homme d’humble origine, Marin Eden, en quête de gloire littéraire. revois toujours avec plaisir. J’ai trouvé particulièrement stimulante cette plongée dans son bouquin.
revois toujours avec plaisir. J’ai trouvé particulièrement stimulante cette plongée dans son bouquin. Également lu, cette semaine, un livre de
Également lu, cette semaine, un livre de 



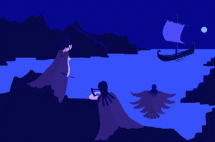

 gauche ou de droite, nulle institution, nul parti, nulle Église, nul mouvement sociopolitique n’est exempt d’erreurs et d’erreurs graves qui trop souvent ont mené à la négation de la dignité humaine. Par contre, on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’exister, pour un être humain, signifie s’engager — l’abstention étant elle-même une forme d’engagement. De plus, il me semble que dans notre monde, la somme d’injustices, d’inégalités injustifiables, est si grande que de se fermer les yeux est pure lâcheté. Or vivre lucidement, à mon avis, ne peut mener qu’à l’engagement en faveur des victimes du système.
gauche ou de droite, nulle institution, nul parti, nulle Église, nul mouvement sociopolitique n’est exempt d’erreurs et d’erreurs graves qui trop souvent ont mené à la négation de la dignité humaine. Par contre, on ne m’enlèvera pas de l’idée qu’exister, pour un être humain, signifie s’engager — l’abstention étant elle-même une forme d’engagement. De plus, il me semble que dans notre monde, la somme d’injustices, d’inégalités injustifiables, est si grande que de se fermer les yeux est pure lâcheté. Or vivre lucidement, à mon avis, ne peut mener qu’à l’engagement en faveur des victimes du système.
 de jeunesse pleine de révolte. Un tel poème en prose peut surprendre de la part d’un homme qui, du moins le croit-on, trouva la paix en Dieu avant de disparaître. Il me semble tout de même nécessaire, ne serait-ce que par amour du vrai, de vous le présenter.
de jeunesse pleine de révolte. Un tel poème en prose peut surprendre de la part d’un homme qui, du moins le croit-on, trouva la paix en Dieu avant de disparaître. Il me semble tout de même nécessaire, ne serait-ce que par amour du vrai, de vous le présenter. Très jeune j’ai rencontré un mage. C’était dans mon esprit, je crois. Il m’a conseillé de renier mon baptême. J’ai donc erré dans des contrées sauvages où je me suis abreuvé de l’urine des forêts. Un jour j’ai rencontré une femme qui avait été élevée par des panthères. Rousse, lumineuse, elle allait nue au milieu des savanes comme l’enfant incomprise du Soleil. Nous partageâmes des minuits d’une lumière intense. Elle m’a révélé les secrets d’une volonté qui ose jouer son rôle primitif dans les dimensions sans nombres de l’esprit. Une telle volonté est théurgique, me dit-elle. J’ai compris qu’il y avait dans le corps des carrefours où le cosmos et le Moi s’épousent parfaitement. J’ai adoré dans le corps du blasphème l’Évangile d’un homme libéré des craintes ataviques qui ne servent que le dieu mauvais, ce dieu sombre qui nous maintient enchaînés dans une prison de fer noire.
Très jeune j’ai rencontré un mage. C’était dans mon esprit, je crois. Il m’a conseillé de renier mon baptême. J’ai donc erré dans des contrées sauvages où je me suis abreuvé de l’urine des forêts. Un jour j’ai rencontré une femme qui avait été élevée par des panthères. Rousse, lumineuse, elle allait nue au milieu des savanes comme l’enfant incomprise du Soleil. Nous partageâmes des minuits d’une lumière intense. Elle m’a révélé les secrets d’une volonté qui ose jouer son rôle primitif dans les dimensions sans nombres de l’esprit. Une telle volonté est théurgique, me dit-elle. J’ai compris qu’il y avait dans le corps des carrefours où le cosmos et le Moi s’épousent parfaitement. J’ai adoré dans le corps du blasphème l’Évangile d’un homme libéré des craintes ataviques qui ne servent que le dieu mauvais, ce dieu sombre qui nous maintient enchaînés dans une prison de fer noire.




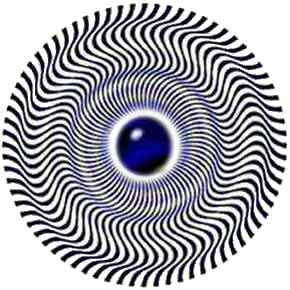


 lecteur mp3. Après la mort de mon ami, j’ai découvert parmi ses papiers ce texte proprement mystique que je crois nécessaire de publier dans le Chat qui louche avec l’aimable soutien de son éditeur. Pour le reste, je préfère taire les circonstances étranges dans lesquelles disparut cet homme qui m’était si cher. Je laisse donc la parole à celui qui me manque :
lecteur mp3. Après la mort de mon ami, j’ai découvert parmi ses papiers ce texte proprement mystique que je crois nécessaire de publier dans le Chat qui louche avec l’aimable soutien de son éditeur. Pour le reste, je préfère taire les circonstances étranges dans lesquelles disparut cet homme qui m’était si cher. Je laisse donc la parole à celui qui me manque :  l’intelligence et de la beauté existe ; que Dieu n’est pas dans un quelconque ailleurs, qu’Il est la dimension profonde de notre réalité dans laquelle tout est accompli, parfait, pacifié ; et qu’Il inspire aux hommes leur désir d’élévation. Quelle ferveur j’éprouvai, quelle reconnaissance ! Plus rien ne m’était étranger, le moindre brin d’herbe m’était un frère. Quelle joie infinie je ressentais ! Comme soudain tout était beau, surnaturellement beau ; comme tout était bien. J’avais franchi le miroir, je vivais dans le monde réel, celui de ma propre éternité, de l’éternité de chacun – et même un brin d’herbe dans son principe est éternel. Oui, quelle joie ! À travers ses luttes parfois immondes, malgré toute la médiocrité dont on est trop souvent témoin, la création couve une joie infinie.
l’intelligence et de la beauté existe ; que Dieu n’est pas dans un quelconque ailleurs, qu’Il est la dimension profonde de notre réalité dans laquelle tout est accompli, parfait, pacifié ; et qu’Il inspire aux hommes leur désir d’élévation. Quelle ferveur j’éprouvai, quelle reconnaissance ! Plus rien ne m’était étranger, le moindre brin d’herbe m’était un frère. Quelle joie infinie je ressentais ! Comme soudain tout était beau, surnaturellement beau ; comme tout était bien. J’avais franchi le miroir, je vivais dans le monde réel, celui de ma propre éternité, de l’éternité de chacun – et même un brin d’herbe dans son principe est éternel. Oui, quelle joie ! À travers ses luttes parfois immondes, malgré toute la médiocrité dont on est trop souvent témoin, la création couve une joie infinie.